





 Poussières de Paris
Poussières de Paris
Jean Lorrain
1902
"Dimanche 4 juin [1899].- (…) ‘Les La Gandara, moi je ne sors pas de là ; sa princesse de Brancovan-Chimay sera un des portraits du siècle ; avez-vous remarqué les mains, comme c’est traité, et quelle race dans la raideur un peu voulue de la taille ; on sent que cette femme-là s’assoit sans jamais s’appuyer, comme nos aïeules au grand siècle, et cette maigreur, et la tête trop petite, accentuée encore par la volumineuse coiffure ; et je vous fais grâce du fini des étoffes : il fait chanter le satin comme Vélasquez. – Oui, on sent que cette petite femme-là est née pour être duchesse, mais j’aime autant le portrait de Madame Salvator ; c’est campé comme un personnage de musée, et la trouvaille de la main mettant la rose à la ceinture, on dirait un objet d’art, je ne sais quelle précieuse et vivante agrafe. Quel motif de fermoir pour Lalique ! Voyez-vous, en jade, là, ces dix doigts posés sur une fleur d’émail, et puis le rose mat de la bouche, est-ce assez à la manière de Whistler ? – Ou de Vélasquez. Vous l’avez déjà dit, vous savez de qui il a commande pour portrait ? – Non. – De Joseph Reinach ; il est en pourparlers  pour peindre mademoiselle Reinach.- Naturellement, peintre attitré des princesses, il peint la fille du souverain : c’est la consécration officielle du talent.- Mieux, je parie qu’il a demande d’achat pour le Luxembourg."
pour peindre mademoiselle Reinach.- Naturellement, peintre attitré des princesses, il peint la fille du souverain : c’est la consécration officielle du talent.- Mieux, je parie qu’il a demande d’achat pour le Luxembourg."
p.146 – "Mercredi 23 août [1899] (…) Les temps sont troubles. Un journal libertaire demande la mise en jugement de nos princesses de Lamballe et votre ami Coquiot, qui, l’autre lundi, à propos du portrait de La Gandara, dénonçait à l’opinion la beauté de la comtesse de Noailles.
La Gandara, vos dîners du Pavillon-Bleu. Revenez-y."
p.212 – "Dimanche 21 janvier [1900].- 22, rue Monsieur-le-Prince, quatre heures et demie, dans l’atelier de M. Antonio de la Gandara (pour la description, voir dans un dernier ‘Phocas’, l’inventaire de l’atelier de Claudius Ethal), atelier nu, très haut, intentionnellement froid, l’air d’une pièce hantée, où deux toiles, deux portraits de femme, l’un datant de dix ans, l’autre d’hier, dressent dans la nuit tombante comme deux spectres attifés d’étoffes.
Le premier, celui d’il y a dix ans, d’un faire plus moelleux et moins sec que ceux que le peintre signe aujourd’hui, évoque le charme félin et rose d’une femme étonnamment blonde, une créature à la carnation de fleur, aux yeux violets d’une expression ambiguë, une femme slave par le mystérieux de la physionomie et de la pose, et que je reconnais pour une actrice, aujourd’hui disparue du théâtre, Sarah Valanoff. L’autre, qui sera un des portraits sensationnels de l’Exposition de 1900, montre, assise sur un somno tendu d’un satin bleu glacé, une énigmatique femme du Premier Empire, gainée dans un fourreau de satin bleu lunaire. Le nu des bras et des épaules luit du blanc froid des nénuphars ; de grands yeux étonnés, à la fois aqueux et sombres, s’irradient dans la pâleur d’un visage de nymphe, une chevelure brune la coiffe de nuit. Sa pose, avec l’eurythmie de ses deux bras écartés de sa taille, est celle d’une pythonisse attendant le dieu ; ils ont, ces bras frêles et froids, la courbe lente d’un cou de cygne, et, dans les luminosités bleues qui la baignent, cette femme est surtout lunaire et nocturne, elle est Hécate aux trois visages, elle est prêtresse d’Artémis en Tauride, ou la Léda de Pierre Louys, et cette délicieuse et sombre figure, où l’on voudrait voir une nymphe de l’Erèbe, est le portrait de la comtesse de Noailles."
p.273 – "Vendredi 4 mai [1900].- Le Grand Bazar.- Coin de l’Exposition.- (…)
Quelques belles.- ‘Je ne les [les hommes de Ceylan] trouve pas aussi bien que cela. (…) Ce petit ? Mais il me viendrait à l’épaule.- Avouez qu’il a un joli profil.- Il rappelle beaucoup ‘la Gandura’.- Le peintre ?- Le peintre, naturellement ; pas l’acteur, celui qui a préparé la princesse Chara à Rigo.- Le fait est qu’il lui ressemble."
p.337 – "Mercredi 1er août [1900].- Une lettre de Paris. ‘Et vous avez manqué la cinquantième de ‘Louise’ et le déjeuner au Moulin de la Galette (…)
Et quel banquet ! Quatre cents couverts. A la table d’honneur, les ministres 5…) la muse de Montmartre, mademoiselle Stump, d’une distinction, ma chère ! (plus qu’archiduchesse, princesse de Galles avec un nez d’une aristocratie et une robe ! un La Gandara) ; (…)"
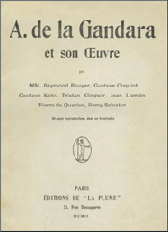 La Plume (Monographie d’Antonio de La Gandara)
La Plume (Monographie d’Antonio de La Gandara)
1902
"Portraits oubliés - En 1893, il y a huit ans, au Champ de Mars, dans la salle même où la folie du mouvement des Espagnoles de Dannat se déhanchait et se tordait, démoniaque et frénétique, pour l’exaspération grande du bourgeois; presque vis-à-vis de cette peinture exacerbée et brutalement poussée au bleu, sur la même cimaise où Boutet de Monvel exposait la nudité sur porcelaine de ses Dianes vaselinées et de ses mondaines aux yeux d’émail, côte à côte, avec les hardiesses voulues et les savants jeux de lumière d’un vrai peintre pourtant, M Alexander, trois grands portraits d’égale hauteur m’attirèrent entre tous par le ton d’agate et la préciosité de leur atmosphère. Avant même d’avoir distingué les personnages debout au milieu de leur cadre, une hallucinante impression de rêve et de réalité m’avait saisi devant ces trois formes non plus fixées sur la toile par des procédés plus ou moins ingénieux, mais apparues bien vivantes d’une vie de mystère dans l’austérité froide de vastes pièces sans meubles, salons à l’abandon de patriciennes demeures, bien propres aux évocations ; et, entre ces hauts cadres, ouverts comme des portes sur le vide de je ne sais quels somptueux intérieurs, régnait cette indéfinissable atmosphère d’ombre fluide et de gris laiteux, atmosphère étrange où les chairs se nacrent et où les bleus s’irisent comme sous un clair de lune et que je ne connais qu’à trois peintres au monde, Reynolds, van Dyck, et Whistler.
Ils représentaient trois femmes, ces portraits, toutes les trois debout, une vieille dame en noir, une jeune femme en vert, une enfant en jaune, l’enfant au milieu, la même boiserie grise aux minces filets d’or courait derrière elles, et les faisait toutes les trois habitantes d’on ne savait quel équivoque salon Louis XVI, ou peut-être, qui sait, égarées dans le long corridor d’une maison Usher. Une même vie de fantôme les animait toutes et leurs ombres portées se tassaient derrière elles, assez inquiétantes pour qu’on craignît la pièce hantée ; mais la jeune femme et l’enfant surtout obsédaient.
Oh ! La dame en vert ! Dans quel conte d’Edgar Poë avis-je déjà rencontré cette jolie tête expressive et si pâle sous l’or yeux de ses cheveux ! Et ces beaux yeux d’un bleu transparent et humide, ces yeux d’eau, ces deux larges prunelles égarées comme plaintives dans la supplication d’un éternel adieu ? Où avais-je déjà vu, aimé, passionnément aimé, adoré et pleuré dans le rêve ou dans la vie, et cette fine pâleur, ce délicat profil, et toute la souffrance de cette aristocratie, frappée elle-même dans sa grâce touchante d’on ne sait quelle stupeur ?
Donia Ligïa, Morella, Bérénice ou peut-être la si mélancolique et délicieuse dame, dont la vie, le regard et le sourire s’évanouirent un soir, quand son ami les eut fixés sur une toile impérissable, la dame qui mourut, soutirée d’elle même par l’odorante ardeur de son peintre, enfermée en tête à tête avec lui ; et des noms de morbides et fuyantes héroïnes, de belles hallucinées encore plus hallucinantes se pressaient sur mes lèvres sans qu’aucun ne convint et ne s’appliquât pourtant à cette douloureuse et charmante, au satiné de cette nuque de neige, au bleu profond de ses yeux brûlants, yeux de larmes et de flammes, comme en a seule l’agonie amoureuse, l’agonie amoureuse d’une âme, âme de mère ou d’amante.
Serrée dans une robe d’un vert gris au corsage un peu raide qui la faisait sans date, elle glissait plus qu’elle ne marchait, d’un pas quasi fantôme, sur la parquet de la haute pièce vide ; le bouffant de ses manches exagérait encore la minceur de son cou et l’on sentait que la lourde traîne de sa robe devait frôler sans bruit, ainsi que dans les rêves. Lente et souple, avec néanmoins une raideur un peu spectrale peut-être dans la taille très droite, elle s’en allait, vue de dos, vers le fond de la pièce, déjà presque enfoncée dans le vague des boiseries. Les apparitions des récits fantastiques ont de ces sorties et de ces glissements. Oh ! elle ne sortait pas de son cadre, elle ne faisait pas la fenêtre au public, mais, déjà entourée de mystère, elle s’effaçait avec sa beauté fragile et condamnée, comme une ombre chérie qui ne reviendra plus ; et c’est le poignant de cet adieu qui vous serrait le cœur, adieu de tout ce corps a demi tourné vers vous et vous jetant, déjà dans l’inconnu, le ne m’oubliez pas de ses yeux résignés.
 Dans le cadre immédiatement voisin du sien, sur le même fond de somptueuses et froides boiseries, une étrange petite fille, très grande pour ses six ans, ouvrait dans un visage d’enfant peureuse et triste, les mêmes larges prunelles transparentes et bleues, les mêmes yeux d’eau hagards et suppliants. Cela devenait hallucinant, je connaissais aussi ses yeux là et j’avais vu cet enfant quelque part ; le costume, il est vrai, dérangeait et déroulait un peu mes souvenirs ; la gaine de soie jaune dont on l’avait affublée, une lumineuse robe d’or toute droite qui en faisait une royale petite Infante, l’arrangement de ses boucles brunes auréolant son jeune front me mettaient moins à l’aise que le portrait de la mère ; car la frêle dame en vert était, certes la mère de cette jolie enfant. Leurs regards vivaient trop de la même souffrance, de la même impression d’inquiétude et de tendresse ardente dans le même bleu de bleuet ; et, ce qui me frappait surtout dans cet enfant, c’est cette façon déjà observée d’ailleurs chez une autre petite fille, où, et quand rencontrée ? de tenir la tête inclinée sur l’épaule ; cette timidité d’attitude, cet effarement un peu craintif de petite âme précoce en arrêt devant la vie et qui se replie frileusement, cet air, comme je l’avais baptisé autrefois chez une autre, de petit oiseau tombé du nid.
Dans le cadre immédiatement voisin du sien, sur le même fond de somptueuses et froides boiseries, une étrange petite fille, très grande pour ses six ans, ouvrait dans un visage d’enfant peureuse et triste, les mêmes larges prunelles transparentes et bleues, les mêmes yeux d’eau hagards et suppliants. Cela devenait hallucinant, je connaissais aussi ses yeux là et j’avais vu cet enfant quelque part ; le costume, il est vrai, dérangeait et déroulait un peu mes souvenirs ; la gaine de soie jaune dont on l’avait affublée, une lumineuse robe d’or toute droite qui en faisait une royale petite Infante, l’arrangement de ses boucles brunes auréolant son jeune front me mettaient moins à l’aise que le portrait de la mère ; car la frêle dame en vert était, certes la mère de cette jolie enfant. Leurs regards vivaient trop de la même souffrance, de la même impression d’inquiétude et de tendresse ardente dans le même bleu de bleuet ; et, ce qui me frappait surtout dans cet enfant, c’est cette façon déjà observée d’ailleurs chez une autre petite fille, où, et quand rencontrée ? de tenir la tête inclinée sur l’épaule ; cette timidité d’attitude, cet effarement un peu craintif de petite âme précoce en arrêt devant la vie et qui se replie frileusement, cet air, comme je l’avais baptisé autrefois chez une autre, de petit oiseau tombé du nid.
Et voilà qu’en rapprochant maintenant le portrait de l’enfant de celui de la mère, une éclaircie se faisait dans ma mémoire, un souvenir d’enfance s’y précisait, et quel souvenir !
Sonyeuse ! et toute la mélancolique et mystérieuse aventure, qui passionna durant dix ans la petite ville de province où j’ai été élevé, revécut tout à coup devant moi ; toute cette douloureuse et quasi tragique aventure d’amour, à laquelle j’ai consacré les premières deux cents pages d’un livre et dont j’ai û rêver et inventer la fin, puisque les hôtes de Sonyeuse disparurent du pays sans avoir laissé pénétrer leur histoire, et que trente ans amoncelés sur une tombe aujourd’hui introuvable n’ont pas encore donné le mot de cette énigme.
Sonyeuse ! et je revois ce grand pavillon Louis XIII enfoui sous les ombrages de son parc dormant ; Sonyeuse et ses pelouses d’avoines et d’herbes folles, où jusqu’à dix ans j’ai passé la plupart de mes journées, admis dans la quiétude du somnolent domaine, grâce à la liaison toute botanique de mon père et du vieux jardinier gardien ; Sonyeuse, du nom des marquis de Sonyeuse, une grande famille de Normandie, dont le marquis vivant venait deux fois par an toucher ses fermages dans le salon de ce pavillon Louis XIII aux volets clos toute l’année ; Sonyeuse, où je ne pénétrai jamais plus, du jour où j’y rencontrai Lord et lady Mordaundt.
Cette belle et triste Lady Mordaundt, à laquelle je songe encore après un quart de siècle, et dont j’ai toujours gardé en moi la vision presque surnaturelle, tant elle m’apparut, du premier jour où je la vis, et dans sa souplesse et dans ses allures, et dans sa grâce frêle, d’une autre race, d’une autre nature autre que ma mère et les femmes que je voyais tous les jours. Les Mordaundt amenaient avec eux dans Sonyeuse une délicate petite fille de sept à huit ans, dont la ressemblance avec sa mère inquiétait ; même adorable et fervente tendresse dans le visage de la mère et celui de l’enfant, même regard effarouché, un peu hagard et comme baigné de larmes dans les prunelles du même bleu intense, et dans toute l’attitude du corps et des gestes, le même charme de victimes comme résignées d’avance à leur sort.
Les Mordaundt résidèrent deux ans dans la petite ville de la côte, au milieu de l’hostilité curieuse de toute une société enragée du mystère dont ce beau couple s’entourait ; ils vécurent là sans recevoir personne d’autre que le médecin, évitant toute liaison et si cloîtrés, si retirés en eux-mêmes, que la malignité provinciale soupçonnait aussitôt une existence irrégulière et démêlait vite un amour coupable exilé là, entre les grands mus de Sonyeuse, retraite en effet indiquée pour des gens obligés à fuir ou à se cacher.
On ne rencontrait Lady Mordaundt que rarement, le dimanche parfois à une messe basse; et toujours l’étrange petite fille avec elle, et son air navré d’enfant trop riche élevée sans amies de son âge, et qui regrette et qui s’ennuie déjà. On la rencontrait plus souvent avec son père lui faisant arpenter les quais à grands pas, et cela jusqu’au jour où éclatait la grande catastrophe de leur vie. Oh ! le soir de décembre où la nouvelle se répandit tout à coup dans la ville, que la petite Mordaundt avait disparu, enlevée et emportée en barque sur un bateau de plaisance mouillé en rade, qu’une femme de chambre l’avait vendue, et que la mère, atteinte d’un transport au cerveau, agonisait avec des gestes de somnambule et le nom de sa fille aux lèvres, inconsciemment répété en une heure deux cents fois. Agonie de huit jours qui passionna jusqu’au délire la petite ville prise enfin de pitié; toute la société suivit le convoi de la malheureuse jeune femme: Lord Mordaundt ou plutôt celui qui se donnait ce nom, quitta la ville dans la huitaine, et Sonyeuse depuis lors est toujours à vendre, les marquis de Sonyeuse n’y reviennent même plus.
Et, chose plus troublante encore que cette mystérieuse histoire, voilà que devant les deux portraits signés la Gandara, ces deux envois de cette année là au Champs de Mars, lla cendre encore moite de larmes d’un souvenir d’enfance devenait de la chair, s’animait, prenait vie, et que la svelte, la blonde et charmante jeune femme, cette anonyme Lady Mordaundt, si mélancolique et si tendre, dont la beauté avait mis en émoi et obsédait encore après trente ans passés l’opinion de mon pays, Lady Mordaundt était là devant moi plus fuyante et plus délicieusement désirable que jadis. C’est elle dont le sourire et le regard perdu me requérait si tristement dans le portrait de la Dame en vert. Entre les montants de son cadre, c’est le regard effarouché et cependant si doux de la petite Hélène Mordaundt qui me regardait à travers les pupilles étrangement dilatées de l’enfant en robe jaune, et, au delà du temps et de l’espace, après plus de vingt cinq ans révolus, les deux dames de Sonyeuse, la mère et la fille, me fixaient l’une et l’autre, à demi souriantes : elles aussi m’avaient reconnu. "
RETOUR A « CRITIQUES »