


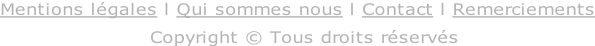


 Jérôme Doucet dans un article intitulé La Femme d’aujourd’hui
Jérôme Doucet dans un article intitulé La Femme d’aujourd’hui
" Antonio de la Gandara – Qui peut se vanter de bien connaître Antonio de la Gandara? Si les portraits qu'il expose sont toujours baignés d'une atmosphère grise de vieux château inhabité, de chambre hantée donnant à ses œuvres je ne sais quoi d'attirant et d'inquiétant à la fois, l'homme lui-même, plus encore, s'enveloppe de mystère et tout est gris dans ce qu'il laisse voir de sa vie, tout est estompé comme le regard alangui de ses yeux noirs et le timbre assourdi, en mineur, de sa voix musicale.
Il est l'homme de ses portraits – peint par lui-même, il descend d'un de ses cadres et si jamais quelqu'un fut bien le reflet de son œuvre, naturellement, sans pose ni affection, c'est bien Antonio de la Gandara.
Mince, élégant, sanglé dans son veston de velours à boutons de métal, il est le peintre des femmes sveltes, amincies, aux épaules saillantes, aux gorges frêles, aux longues mains aristocratiques.
Car il peint les mains comme personne – sauf Carrière – des mains qui sont tout l'être, voyez surtout – si l'on veut un exemple, dans le portrait de Mme Salvator – cette main gauche sur laquelle s'appuie la délicieuse figure d'une femme vraiment jolie, comme elle dit toute l'aristocratique beauté de la portraiturée.
veut un exemple, dans le portrait de Mme Salvator – cette main gauche sur laquelle s'appuie la délicieuse figure d'une femme vraiment jolie, comme elle dit toute l'aristocratique beauté de la portraiturée.
Son atelier, de même, est gris, sombre, ouaté de mystère, il est immense, presque sans meubles. Des roses pâmes se fanent dans une grande tulipe de verre, mi-pleine d'une eau triste, dans l'angle la note citron d'une vieille soie Louis XVIII qui recouvre une banquette d'acajou, roide, style empire. Au milieu, une estrade, basse, voilée d'un tapis vieillot, grisâtre et par dessus une chaise, roide aussi, toujours Empire, -- à côté sur un chevalet une très grande toile, recouverte d'un nuage léger.
Et voici qu'en fixant cette ombre qui va du cadre au centre du tableau en s'adoucissant, en se précisant, un fantôme apparaît, un être se dessine, se modèle, se précise avec une telle apparence de vie, qu'on se détourne pour regarder sur l'estrade le modèle qui doit être assis sur la chaise qui l'attendait, le modèle qui se reflète dans la toile, car les portraits de la Gandara sont les images des êtres dans un miroir magique. Si maintenant on s'approche de cette chose, on voit combien la façon de peindre de la Gandara est simple. Les couleurs délayées à l'essence couvrent à peine la toile, dont le grain est fort gros, dont la porosité boit la touche presque entièrement – on croirait presque une aquarelle.
 Cà et là de très légers glacis, jamais d'empâtements, renforcent, précisent l'ensemble, çà et là des lueurs jaillissent soulignant un bijou, fixant le pli aigu d'un satin, la rougeur d'une lèvre, l'éclat perfide d'un regard. L'ensemble est gris, mais souvent ce gris laisse voir au travers de sa brume un ton, un ton passé, un vert éteint comme dans le portrait de la Comtesse de Noailles ou un rose triste comme dans celui de la Princesse de Chimay quelquefois des étoiles s'allument dans le crépuscule comme les perles d'acier au boléro noir de la Dame à la Rose, autre représentation de la grâce précieuse de Madame Salvator. Gandara est parvenu à passer une ombre de brun norvégienne sur la frimousse gamine de Polaire du bon Willy.
Cà et là de très légers glacis, jamais d'empâtements, renforcent, précisent l'ensemble, çà et là des lueurs jaillissent soulignant un bijou, fixant le pli aigu d'un satin, la rougeur d'une lèvre, l'éclat perfide d'un regard. L'ensemble est gris, mais souvent ce gris laisse voir au travers de sa brume un ton, un ton passé, un vert éteint comme dans le portrait de la Comtesse de Noailles ou un rose triste comme dans celui de la Princesse de Chimay quelquefois des étoiles s'allument dans le crépuscule comme les perles d'acier au boléro noir de la Dame à la Rose, autre représentation de la grâce précieuse de Madame Salvator. Gandara est parvenu à passer une ombre de brun norvégienne sur la frimousse gamine de Polaire du bon Willy.
C'est ce qui fait que jamais un portrait de la Gandara ne peut être confondu avec une toile d'un autre peintre. C'est ce qui fait que jamais on ne passe sans s'arrêter, sans éprouver une impression devant un morceau de peinture de lui.
Deux personnes ont excellemment écrit sur la Gandara. Camille Mauclair et Jean Lorrain. Mauclair a analysé sa peinture avec des raffinements qui rappellent ceux du peintre, Lorrain a parlé de l'homme avec une fantaisie qu'excuse le mystérieux caractère de la Gandara.
Mais pendant que Mauclair se laissait entraîner en d'exquises variations, en d'adorables harmonies de mots qui dépassent la peinture, Lorrain assombrissait encore, dramatisait les choses en des pages morbides. Le La Psara, de M. de Phocas, a un atelier qui ressemble diablement à celui de la Gandara, plus que les deux noms encore, et cette ressemblance vient de ce que Lorrain a songé en écrivant son livre à Whistler comme à la Gandara. Et cela vient de ce que La Gandara est un émule, un élève, le seul élève de Whistler qui n'eut jamais et ne voulut jamais avoir d'élève, cela vient de ce qu'il est impossible de parler de La Gandara sans parler de Whistler, parce que, chose étrange, La Gandara, l'Espagnol revient à Vélasquez, le grand peintre de son pays, en passant par Whistler, l'Anglais, issu tout entier de la géniale maîtrise du grand Castillan.
L'on peut penser tout ce que la Gandara a pu, par son talent et par sa nature grise et mystérieuse, attirer sur lui de jalousies et de médisances. A côté des histoires curieuses de Lorrain, que de papotages de concierges. Lui a-t-on assez reproché d'être le peintre favori de Liane de Pougy. Eh ! Quoi, si la jolie théâtreuse ne connaît pas un artiste capable de mieux traduire son visage délicat, pourquoi se priverait-elle de cette satisfaction et qui peut s'en plaindre ?… Ainsi a-t-il fait d'elle quatre ou cinq effigies qui représentent sans monotonie, la même personnalité.
de jalousies et de médisances. A côté des histoires curieuses de Lorrain, que de papotages de concierges. Lui a-t-on assez reproché d'être le peintre favori de Liane de Pougy. Eh ! Quoi, si la jolie théâtreuse ne connaît pas un artiste capable de mieux traduire son visage délicat, pourquoi se priverait-elle de cette satisfaction et qui peut s'en plaindre ?… Ainsi a-t-il fait d'elle quatre ou cinq effigies qui représentent sans monotonie, la même personnalité.
Vous souvient-il de ces deux portraits que La Gandara exposa en l'an 1893 : La Dame en vert et La fillette en jaune? Devant ces toiles tout le monde s'arrêtait. Quelle était cette mystérieuse femme, cette étrange beauté que l'on ne retrouvait point dans la foule élégante du vernissage ? Et Lorrain s'écria : "Je la reconnais – je reconnais ces yeux tristes guettés par le drame – et Lorrain raconta que c'étaient les portraits de Lady Mordaunt et de sa fille. (…) Et vous devez penser comme on regarda, après cette belle histoire de brigands, les peintures de la Gandara; des yeux humides, effarés, questionneurs, s'accrochèrent aux deux toiles, et de la sorte les admirèrent comme elles méritaient. La curiosité les désigna, leur mérite, le talent du maître fit le reste.
Depuis la vogue de la Gandara, vogue méritée, s'accentua, les femmes de l'aristocratie, les Américaines blasées, ont voulu poser devant lui, et nul n'a su comme lui fixer leur race ou leur orgueil. A ce métier, il eût pu devenir riche, il eût pu, comme tant d'autres faire en une heure, un pastel de dix louis, acheter de bons titres, il eût pu, chaque mois, abattre son portrait payé son pesant d'or. Non. La Gandara hait le commerce, et cet homme est gentilhomme jusqu'au bout des doigts, grand d'Espagne jusqu'à la pointe du pinceau.
Il mourra pauvre parce que ce portrait pourtant payé royalement ne compense pas avec son or le talent, l'effort, les heures, les jours, les années, oui les années, que la Gandara dépensa pour fixer sur une toile qui semble pourtant si peu couverte, si peu fatiguée, non pas seulement une banale ressemblance de traits, photographiquement reconnaissable, mais même l'expression vivante, d'un cerveau, d'une grâce, d'une nature, d'une âme, et aussi d'un cœur…."
RETOUR A « CRITIQUES »